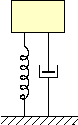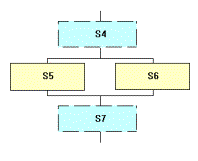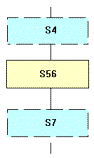Principe
de la méthode d’écriture des spécifications
par équivalence des dommages par fatigue
Les anciens documents normatifs, et certains encore, spécifient des valeurs d’environnement (accélérations, températures, …) à appliquer aux matériels en fonction de leurs conditions d’utilisation. Les valeurs proposées sont en général très sévères, et parfois mal adaptées aux besoins actuels.
Les normes plus récentes MIL-STD 810 aux Etats Unis, GAM EG 13 en France et OTAN demandent plutôt de « personnaliser les essais », soit d’écrire les spécifications à partir de mesures de l’environnement réel. Elles s’appuient sur une démarche en quatre étapes :
1. Ecriture et analyse du profil de vie, précisant l’ensemble des conditions d’emploi du matériel, en notant chacune des situations (stockage, transport, …), puis pour chaque situation, de manière qualitative, établissement d’une liste de tous les environnements nécessitant une représentation particulière (« événements ») avec leur durée et leur ordre chronologique (pour un transport aérien, les vibrations relatives au roulage sur la piste, au décollage, à l’atterrissage, au vol croisière, …),
2. Recherche de données d'environnement réel représentatives de chacun des événements identifiés, en nombre suffisant pour tenir compte de la variabilité inhérente à ces phénomènes,
3. Synthèse des données pour en déduire une spécification de durée réaliste. Cette opération est indispensable compte tenu du nombre important de mesures recueillies en général : plusieurs situations composées de plusieurs événements, chacun décrit par plusieurs mesures, avec 3 axes pour l’environnement vibratoire,
4. Établissement du programme des essais.
Ce processus permet d’élaborer une spécification adaptée à l’utilisation du matériel, avec des marges raisonnables et maîtrisées, et de concevoir le matériel sans le sur-dimensionner.
Il nécessite toutefois de disposer d’une méthode de synthèse des données permettant de garantir que la spécification obtenue a une sévérité au moins égale à celle de l’environnement réel, mais sans excès, et de réduire la durée des essais quand l’environnement est de longue durée.
Nous nous intéresserons ici plus particulièrement au domaine des vibrations et chocs mécaniques.
Principe de la méthode utilisant les S.R.E. et S.D.F.
Les spécifications sont en général écrites en début de projet, et par conséquent à un stade où l’on ne dispose d’aucune information sur le comportement dynamique du matériel (fréquences propres, amortissements, …).
En ce qui concerne les vibrations, deux critères d’endommagement peuvent être retenus pour les comparaisons de sévérité :
|
- la contrainte la plus grande engendrée sur un système à un degré de liberté (de façon analogue au S.R.C.), - le dommage par fatigue créé sur ce même modèle consécutif à l’accumulation des cycles de contrainte pendant toute la durée des sollicitations. |
|
Ces deux critères conduisent à deux catégories de spectres, le spectre de réponse extrême et le spectre de dommage par fatigue, qui seront utilisés aussi pour l’écriture de spécifications (reproduisant en essai les contraintes les plus grandes et les dommages par fatigue produits par les vibrations de l’environnement réel).
Définitions
Spectre de réponse extrême
Le spectre des réponses extrêmes (S.R.E.) [ANN 92][LAL 99d] est défini comme une courbe donnant la valeur du pic le plus grand zsup de la réponse d'un système linéaire à un degré de liberté à la vibration, en fonction de sa fréquence propre f0 , pour un amortissement x donné. La réponse est ici décrite par le déplacement relatif z(t) de la masse par rapport à son support, et l'axe des ordonnées porte, par analogie avec le spectre de réponse au choc, la quantité (2p f0)2 zsup .
Spectre de dommage par fatigue
Le spectre de dommage par fatigue (S.D.F.)d'une vibration est obtenu en traçant les variations du dommage subi par un système linéaire à un degré de liberté en fonction de sa fréquence propre f0 , pour un amortissement x donné.
Synthèse des données
Une synthèse des données collectées est effectuée pour chaque événement, puis pour chaque situation et enfin pour tout le profil de vie.
Pour chaque événement :
Les données disponibles peuvent être,
- pour les chocs, des signaux en fonction du temps, dont on calcule des spectres de réponse au choc (S.R.C.), ou bien directement des S.R.C. issus d’une base de données,
- pour les vibrations aléatoires,
o des signaux en fonction du temps lorsque la vibration n’est pas stationnaire ou lorsque le signal n’est pas gaussien,
o des signaux en fonction du temps dont on calcule des D.S.P. lorsque la vibration est stationnaire et gaussienne, ou directement les D.S.P. elles-mêmes extraites d’une base de données.

Figure 1. Exemples d’événements dans une situation
Pour chaque événement de type choc, pour tenir compte de la variabilité du phénomène, on calcule à chaque fréquence la moyenne et l’écart type des S.R.C., puis le coefficient de variation
![]()
(CVE est fonction de la fréquence). Avec une hypothèse sur la distribution des spectres (loi log-normale le plus souvent) et sur la dispersion de la résistance du matériel qui sera soumis à l’essai (coefficient de variation CVR), on en déduit un coefficient de garantie k(f) associé à une probabilité de défaillance maximum admissible P0. Le choix de P0 est fonction du niveau de fiabilité ou de sécurité souhaité pour le matériel. Le coefficient 1-P0 est appliqué sur le spectre moyen pour définir la sévérité des essais à réaliser. Les essais permettront donc de démontrer que, compte tenu des variabilités de l’environnement et de la résistance, le matériel aura une probabilité 1-P0 de fonctionner correctement dans son futur environnement [LAL 99e].
A partir de chaque signal en fonction du temps ou D.S.P. caractérisant les vibrations aléatoires (cf. Question 24), un spectre de réponse extrême et un spectre de dommage par fatigue sont calculés. Pour chacun des événements, on suit la même démarche que pour les chocs à partir de ces deux catégories de spectres (figure 2).
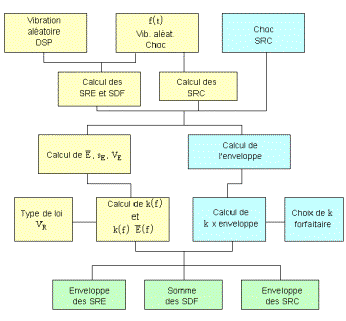

Figure 2. Processus d’établissement d’une spécification
Chaque événement est donc caractérisé, après cette analyse, soit par un S.R.C. s’il s’agit d’un choc, soit par un S.R.E. et un S.D.F. s’il s’agit d’une vibration aléatoire (ou sinusoïdale).
Pour chaque situation :
On procède à :
· l’enveloppe de tous les S.R.C. ainsi obtenus dans cette situation,
· l’enveloppe des S.R.E.,
· la somme, à chaque fréquence, de tous les S.D.F. (les dommages s’additionnent linéairement selon l’hypothèse de Miner).
A l’issue de ces opérations, chaque situation est caractérisée par 3 spectres (S.R.C., S.R.E. et S.D.F.).
Recherche d'une vibration aléatoire de même sévérité
Ces spectres sont ensuite combinés comme suit.
Situations en parallèle
Dans ce cas, le matériel n’est soumis qu’à l’un ou à l’autre des environnements. On procédera donc successivement à l’enveloppe des S.R.E., des S.D.F. et des S.R.C. des situations en parallèle. Les courbes obtenues seront à considérer comme celles d’une situation équivalente en série avec les situations connexes.
|
|
|
|
Figure 3. Traitement des situations en parallèle
|
Figure 4. Situations en série |
Situations en série Le matériel sera soumis à toutes les situations en série. Il faut donc faire
|
L’ensemble du profil de vie peut alors être représenté par trois spectres équivalents (figure 5).

Figure 5. Processus de validation de la spécification
Recherche d'une vibration aléatoire de même sévérité
Pour des raisons évidentes de coût, on ne procède en général qu’à un seul essai, qui ne permet pas à lui seul de démontrer la tenue de l’ensemble des matériels avec la probabilité affichée, compte tenu de la variabilité de sa résistance. A partir de l’estimation du coefficient de variation de cette résistance, il faut donc appliquer un facteur multiplicatif supplémentaire fonction du nombre des essais envisagés, le « facteur d’essai ».
Téléchargement COGAR (calcul du coefficient de garantie et du facteur d'essai).
LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ
L'auteur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement
du logiciel et pour d'éventuels dommages
subis par l'utilisateur après l'installation, lors de l'utilisation du
logiciel et résultant de l'utilisation du logiciel.
L'utilisateur renonce expressément à exercer tout recours à ce sujet
contre l'auteur du programme. L'installation
du logiciel vaut acceptation pleine et entière des présentes
dispositions.
Ce logiciel est protégé par le droit d'auteur: sa commercialisation sous
quelques formes ou méthodes que ce soit
est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur (vibration.choc@free.fr).
Etablir la spécification va ensuite consister à rechercher les caractéristiques
¨ d'une vibration aléatoire définie par sa D.S.P. qui, sur une durée choisie, a un S.D.F. très proche de celui résultant de la précédente synthèse (spectre de référence). Cette méthode inclut donc de facto la possibilité d'une réduction de la durée des essais. La règle de réduction, par équivalence des dommages par fatigue, est celle présentée dans la Question 18.
¨ d’un choc ayant un S.R.C. très proche du S.R.C. du profil de vie. La spécification peut aussi être directement ce S.R.C. s’il est possible de le respecter lors d’un essai sur excitateur en mode pilotage à partir du S.R.C..
Utilisation des S.R.E. pour valider la réduction de durée
Cf. Question 16.
Regroupements
La démarche présentée ici concernait l’ensemble des situations du profil de vie. Très souvent, il est souhaitable de scinder le profil de vie en différents blocs qui conduiront à plusieurs spécifications. Les raisons peuvent être, par exemple
-
la nécessité de réaliser un essai de fonctionnement d’un équipement sous un environnement vibratoire particulier, plutôt que sous une vibration couvrant diverses situations très différentes, qui rendrait difficile l’interprétation des résultats en cas d’échec,
-
la nécessité d’effectuer un essai combiné composé, par exemple, d’une vibration spécifique et un essai thermique simulant un emport sous avion.
Il est alors souhaitable de regrouper les situations en blocs qui prendront en compte ces spécificités et conduiront chacun à une spécification de vibration aléatoire et éventuellement à un choc, pour chaque axe. La présence de ces diverses épreuves donne tout son sens à la quatrième étape du processus, l’établissement du programme des essais, dans laquelle on organise la séquence de ces épreuves à partir d’un compromis entre la représentativité de l’enchaînement des essais (par rapport au profil de vie) et leur coût.
* *
*
La méthode par équivalence des dommages s’appuie sur des spectres (S.R.E. et S.D.F.) qui permettent:
-
d’harmoniser le traitement des vibrations et des chocs en généralisant l’usage du modèle de S.R.C.,
-
de comparer la sévérité de spécifications et/ou d’environnements réels à partir de critères mécaniques (contrainte maximale, dommage par fatigue),
-
de comparer la sévérité de tous types de vibrations : sinus, sinus balayé, aléatoire, bruit à bande étroite balayé sur bruit blanc, raies sinus balayées sur bruit blanc, … Les références [CLA 98] [RIC 01] en donnent des exemples.
Elle présente en outre les principaux avantages suivants [LAL 04]:
-
bien qu’utilisant les mêmes hypothèses de base pour la réduction des durées, elle permet de définir une épreuve mieux adaptée dans le cas d’une spécification couvrant une succession de vibrations de durée réelles et de contenus en fréquence très différents, avec un choix plus libre et donc plus personnalisé de la valeur du paramètre b,
-
toutes les vibrations, stationnaires, non stationnaires, gaussiennes ou non gaussiennes, peuvent être prises en compte,
-
elle permet en fait, dans l’absolu, de réduire tout un profil de mission en une seule spécification de vibrations aléatoire et en un choc (par axe), même si, en pratique, pour diverses raisons (essais combinés vibrations/thermique, test de fonctionnement sous une vibration particulière du profil de mission, …) on peut être conduit à élaborer plusieurs spécifications regroupant un certain nombre de situations,
-
existence d’un processus de validation de la réduction de durée,
-
insensibilité à la valeur de la surtension qu’il est nécessaire d’introduire dans les calculs,
-
insensibilité à la valeur du paramètre b choisi, en l’absence d’une réduction de la durée.
-
reproductibilité des résultats obtenus quel que soit l’opérateur, même lorsque les données de base (conditions de calcul des D.S.P. par exemple) sont différentes [LAL 99d] [RIC 93].
-
possibilité d’inclure un coefficient de garantie pour se prémunir contre la variabilité de chaque environnement réel et celle de la résistance, fonction d’un risque considéré comme admissible,
-
possibilité d’augmenter la sévérité des épreuves pour tenir compte de la réalisation d’un seul essai pour démontrer expérimentalement la tenue du matériel à l’environnement,
-
possibilité de déterminer une spécification même dans le cas d'un environnement réel non stationnaire,
-
pas d'hypothèse complémentaire par rapport à la méthode classique utilisant des enveloppes de D.S.P. avec une réduction de temps pour les vibrations et les S.R.C. pour les chocs [LAL 02].
Cette méthode nécessite un travail sans doute un peu plus important lors de l’écriture des spécifications, mais l’investissement est largement récupéré lors du développement, les spécifications ainsi obtenues permettant de concevoir un matériel dimensionné au strict besoin, parfaitement adapté à son futur environnement. Ce travail d’analyse est grandement facilité par l’existence d’outils informatiques, sous Windows ou sous Unix, qui permettent d’effectuer tous les calculs des spectres et leur combinaison de manière automatique, jusqu’à l’édition de la spécification.
- o O o -